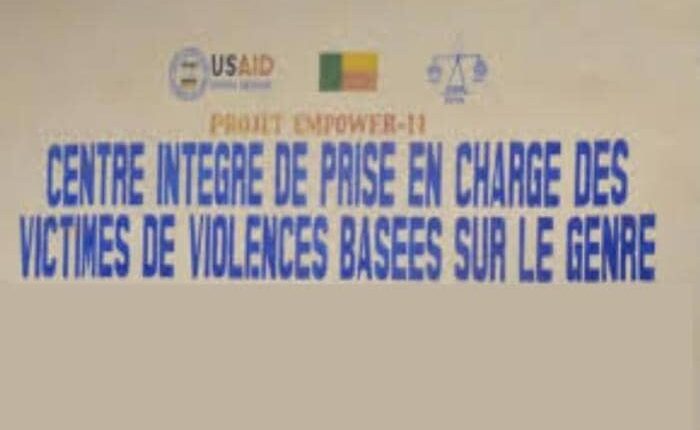Le Bénin est confronté à une montée inquiétante des violences basées sur le genre (VBG), notamment des violences sexuelles. Selon l’Institut National de la Femme (INF), plus de 1500 cas de viols ont déjà été enregistrés au premier trimestre 2025 seulement, contre 200 cas en 2021-2022, 1117 en 2023, et plus de 2000 en 2024. Cette hausse spectaculaire témoigne autant d’un éveil des consciences que de la persistance du phénomène. Les données statistiques du Sidoffe-NG, indiquent que, de 2020 à 2024, 58 328 cas de VBG ont été pris en charge au niveau national, dont 26 983 dans les structures dédiées, 7909 référés à la police ou à la justice, et 3871 vers les formations sanitaires. Aucun département n’est épargné : du Zou (9590 cas) à l’Alibori (3372 cas) en passant par l’Ouémé (7018) ou le Borgou (6392), le fléau est généralisé.
Dans ce contexte, les Centres Intégrés de Prise en charge des cas de Violences Basées sur le Genre (CIPEC-VBG) apparaissent comme des réponses indispensables, encore trop peu nombreuses pour couvrir les besoins croissants. Leur renforcement et leur déploiement équitable sur tout le territoire s’imposent comme une urgence humanitaire et un impératif politique. Ces centres offrent un accompagnement holistique aux survivantes : soins médicaux, soutien psychologique, assistance juridique, hébergement d’urgence et réinsertion sociale.
Pour Enongandé M. Hélèna Capo-Chichi, socio-anthropologue spécialiste des questions de genre et présidente de l’ONG Famille-Nutrition-Développement (FND), le déploiement des CIPEC à l’échelle nationale est une priorité vitale. « Les victimes de VBG vivent souvent un véritable calvaire pour accéder à une aide appropriée. Elles doivent se débrouiller seules pour aller du commissariat à l’hôpital, chercher un psychologue, un avocat, parfois même un abri… Le CIPEC est la réponse à cette errance institutionnelle. »
Elle insiste sur l’importance d’un guichet unique où tous les services sont coordonnés, accessibles et sécurisants pour les victimes, souvent vulnérables, traumatisées et stigmatisées. Mais elle alerte aussi sur le risque d’un déploiement symbolique : « Ce n’est pas une question de plaques ou de bâtiments, mais de fonctionnement réel, de ressources humaines compétentes, et de volonté politique ferme. »
Un besoin d’hébergement d’urgence dans toutes les communes
À ses côtés, Hermine Bokossa, spécialiste en genre et gestionnaire de projet, souligne l’importance de l’hébergement dans le processus de prise en charge : « Je pense qu’il est indispensable d’avoir des hébergements d’urgence dans tous les départements, dans toutes les communes du pays. Et les CIPEC seraient idéaux pour une prise en charge holistique. »
Pour elle, la territorialisation de ces structures est une condition essentielle à leur efficacité. Elle appelle à une prise en compte des réalités locales et à un maillage national équitable pour que chaque victime, où qu’elle soit, puisse bénéficier de protection et de soins dignes.
Un déploiement progressif mais engagé, selon les autorités
Interrogé sur la lenteur du déploiement, Noah Agbaffa Padonou, Directeur départemental des Affaires sociales et de la Microfinance du Littoral, tempère les critiques : « Nous ne sommes qu’à quatre CIPEC aujourd’hui, mais c’est un processus progressif. Vous aurez constaté que celui des Collines est tout récent. Cela montre que les choses avancent. »
Conscient de l’urgence, il met cependant en avant les limites budgétaires : « Nous sommes dans un pays aux moyens relativement limités, mais les ambitions sont grandes. L’effort est en cours et chaque jour, on progresse vers une couverture plus large. »
L’option des CIPEC virtuels : innover pour accélérer l’accès aux services
Face à ces contraintes, une solution innovante est à l’étude : les CIPEC virtuels. Selon M. Padonou, ces centres numériques pourraient permettre d’atteindre les populations éloignées sans attendre la construction d’infrastructures physiques : « On peut totalement dématérialiser certains services. L’ARCEP a montré que la quasi-totalité des Béninois disposent d’une carte SIM. C’est une opportunité pour offrir des prestations à distance, grâce au numérique. »
Ce projet, encore en maturation, pourrait permettre de gagner du temps, de l’espace et des ressources tout en maintenant une certaine qualité de service, notamment pour l’écoute, l’orientation et la sensibilisation.
Un dispositif qui doit s’accompagner d’une meilleure sensibilisation
Le directeur départemental a aussi abordé un point sensible : la difficulté d’accès au certificat médical, souvent dénoncée par les victimes. Pour lui, ce n’est pas une question d’indisponibilité, mais de méconnaissance du processus : « Il faut une réquisition de l’officier de police avant que le médecin ne puisse délivrer le certificat. Quand ce protocole est ignoré, le processus bloque. D’où l’importance de renforcer l’information et la coordination. »
Entre espoir et vigilance
Si les CIPEC incarnent une avancée majeure dans la lutte contre les VBG au Bénin, leur réussite dépendra de plusieurs facteurs : volonté politique, financement stable, implication communautaire, renforcement des compétences et innovation technologique. Pour Enongandé M. Hélèna Capo-Chichi, seule une mobilisation collective et cohérente permettra de faire des droits des femmes et des filles une réalité vécue, et non un simple vœu institutionnel.
Abbas TITILOLA en Collaboration avec Alliance Droits et santé