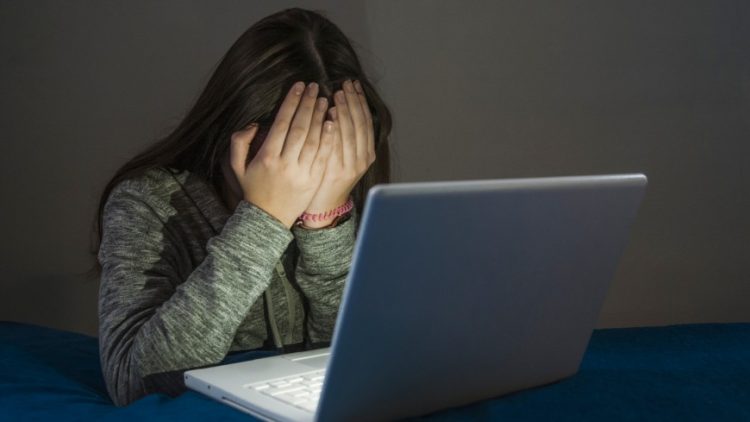La montée fulgurante du numérique a apporté son lot d’opportunités… mais aussi de menaces, notamment pour les femmes et les filles. Les violences basées sur le genre en ligne (VBG en ligne) constituent aujourd’hui une réalité préoccupante au Bénin. Face à ce phénomène, la loi n°2017-20 du 20 avril 2018, portant Code du numérique en République du Bénin, prévoit un cadre juridique robuste pour en limiter les effets et sanctionner les auteurs.

Les VBG en ligne désignent l’ensemble des actes de violence perpétrés à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC), visant une personne en raison de son genre. Ces violences peuvent prendre la forme de cyberharcèlement ou de menaces en ligne, de diffusion non consentie d’images ou de vidéos intimes (communément appelé « revenge porn »), d’usurpation d’identité dans le but de nuire à la réputation, de propos sexistes ou dégradants sur les réseaux sociaux, ou encore de traçage et de surveillance numérique (cybertraque).
Le Système Intégré de Données sur les Formes de Violences Faites aux Femmes et aux Enfants – Nouvelle Génération (SIDoFFE-NG), piloté par le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, reconnaît officiellement les VBG en ligne comme une forme spécifique de violence. Le système contient désormais 342 indicateurs, dont 120 spécifiquement liés aux violences faites aux femmes et aux filles, incluant les violences numériques.
Les VBG en ligne sont souvent commises de manière anonyme, ce qui complique leur dénonciation et leur répression. Pourtant, leurs conséquences psychologiques, sociales, voire physiques, sont bien réelles. En témoigne Rosemonde, une victime : « À chaque fois que je publie quelque chose sur Facebook, un inconnu vient commenter avec des insultes. Il écrit que je suis une fille facile, une prostituée, que je n’ai aucune valeur. J’ai signalé son compte plusieurs fois, mais rien ne change. C’est humiliant. »
Une autre, Sandra, confie : « J’ai refusé de retourner avec mon ex. En colère, il a menacé de publier mes photos privées qu’il gardait dans sa galerie. Je n’ai pas pris la menace au sérieux, jusqu’au jour où, un beau matin, j’ai vu mes photos circuler sur les réseaux sociaux. Depuis, je n’ose plus sortir, je me sens salie. »
Ce que dit la loi
La loi n°2017-20 du 20 avril 2018 ne mentionne pas explicitement les “violences basées sur le genre en ligne”, mais elle contient plusieurs dispositions qui s’appliquent directement à ce type d’infractions. L’article 550, par exemple, punit toute communication électronique initiée dans le but de contraindre, intimider, harceler ou provoquer une détresse émotionnelle. Les sanctions prévues vont de un mois à deux ans d’emprisonnement, assorties d’une amende de 500 000 à 10 000 000 FCFA. L’article 574 traite des atteintes à la vie privée, comme la captation ou la diffusion non autorisée de paroles, d’images ou de vidéos, et prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement avec une amende de 25 000 000 FCFA. Quant à l’article 521, il condamne la corruption de mineurs en ligne, notamment dans les établissements scolaires, avec des peines pouvant aller jusqu’à douze ans d’emprisonnement et 35 000 000 FCFA d’amende.
Les institutions chargées de l’application de la loi
Trois institutions principales sont chargées de faire respecter ces dispositions. L’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) veille au respect des droits relatifs aux données personnelles. Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN), qui a succédé à l’ex-OCRC, est chargé des enquêtes et poursuites en matière de cybercriminalité. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) s’occupe de la sécurité des systèmes et réseaux d’information.
Défis à surmonter pour une protection efficace
Malgré l’existence de ce cadre légal, plusieurs obstacles limitent la protection effective des victimes. L’anonymat en ligne permet aux agresseurs de masquer leur identité, rendant leur traçabilité difficile. La méconnaissance des droits par les victimes constitue également un frein à la dénonciation. À cela s’ajoutent les tabous sociaux qui poussent certaines femmes au silence par peur de stigmatisation ou de représailles. Par ailleurs, peu de plaintes aboutissent à des poursuites, notamment à cause du manque de moyens techniques ou de formation des agents de sécurité. Enfin, la coopération internationale demeure limitée, car les grandes plateformes numériques comme Facebook, WhatsApp ou TikTok échappent souvent à la juridiction béninoise, rendant difficile la suppression rapide des contenus incriminés ou l’identification des auteurs.
Le Bénin dispose, à travers le Code du numérique, d’un arsenal juridique moderne pour sanctionner les violences sexistes et sexuelles commises en ligne. Toutefois, pour garantir une réelle protection des victimes, il est indispensable de renforcer la sensibilisation des populations, de former les forces de sécurité et les acteurs judiciaires, et de favoriser le signalement des faits. La lutte contre les violences basées sur le genre en ligne doit être une priorité partagée entre les autorités, la société civile, les entreprises du numérique et chaque citoyen.
Abbas TITILOLA
avec la collaboration de CeRadis Ong, membre de l’Alliance Droit et Santé